Sciences : « Les grandes orientations doivent être données par les citoyens »
 Biologiste retraité des laboratoires, Jacques Testart s’est d’abord fait connaître en participant aux recherches sur la fécondation in vitro qui a permis la naissance du premier « bébé éprouvette » en 1982, avant de se faire critique de sciences. À travers une vingtaine d’ouvrages, il dénonce depuis 20 ans les dérives de ces recherches et des sciences en général, et milite pour une démocratisation du secteur scientifique.
Biologiste retraité des laboratoires, Jacques Testart s’est d’abord fait connaître en participant aux recherches sur la fécondation in vitro qui a permis la naissance du premier « bébé éprouvette » en 1982, avant de se faire critique de sciences. À travers une vingtaine d’ouvrages, il dénonce depuis 20 ans les dérives de ces recherches et des sciences en général, et milite pour une démocratisation du secteur scientifique.
D’où est venu votre intérêt pour les liens entre sciences et société ?
C’est un cheminement de 30 ans, émaillé d’expériences et de déceptions. Je suis devenu chercheur en 1964, je travaillais sur la multiplication de vaches de haute qualité laitière, par le biais de transplantations d’embryons. En les transférant dans plusieurs vaches, l’objectif était d’obtenir plusieurs petits d’une même vache performante chaque année. Les premiers veaux issus de ces recherches sont nés en 1972. Dans le même temps, les éleveurs bovins connaissaient une grave crise en raison de la surproduction de lait et il y avait même des primes à l’abattage. J’ai réalisé alors le hiatus entre ce programme de recherche et le bien commun. Cela m’a amené à réfléchir au rôle de la science pour la société, à ce qu’elle pouvait apporter aux citoyens. J’ai changé de métier et je suis allé travailler à l’hôpital sur la fécondation in vitro humaine, où j’ai très vite réagi aux dérives : la course à l’argent, le rapport infernal aux médias, les actions aventureuses, etc. On touchait là à l’humain, et pourtant, je me suis vite aperçu qu’il n’y avait pas plus d’éthique qu’avec les vaches. J’ai été déçu car je pensais jusque-là que les sciences étaient ce qui allait sauver le monde. J’ai pris conscience que, comme la plupart de mes collègues, je faisais de la technologie et non de la science, cette dernière consistant à apporter des connaissances sur le monde. J’étais complètement dégouté et j’ai commencé à alerter l’opinion publique sur ces questions. En 2002, j’ai rencontré d’autres chercheurs conscients et on a créé l’association pour une Fondation des sciences citoyennes.
 Depuis quand les sciences sont-elles devenues un sujet d’inquiétude et de débat ?
Depuis quand les sciences sont-elles devenues un sujet d’inquiétude et de débat ?
En général, on fait remonter cela à Hiroshima. Auparavant, il y avait bien sûr déjà des inquiétudes, mais plus ponctuelles. Par exemple lorsqu’on a installé le gaz à Paris au 19ème siècle, des gens ont eu peur des incendies, de la toxicité. Il y a toujours eu des technologies nouvelles, mais le problème aujourd’hui, c’est qu’il n’y en a pas une, mais plein qui font irruption et qui évoluent très rapidement. On n’a pas le temps de s’habituer ou de s’interroger sur leurs conséquences. Avec la bombe atomique, la science a montré qu’elle pouvait créer la mort et depuis les Trente Glorieuses, elle est devenue un bizness. Il y a aussi une confusion entre les sciences et les technosciences, qui sont le côté spectaculaire de la science, et qui sont financées par des entreprises dans une optique de profit. Les sciences disparaissent au profit des technosciences, avec des chercheurs qui ne travaillent pas pour la connaissance mais pour concevoir des produits d’innovation à commercialiser. Même si on parle toujours de sciences, on fait en fait de la technoscience dans tous les domaines, mis à part peut-être certains physiciens théoriciens et des mathématiciens.
Des voix s’élèvent pour dénoncer la course aux publications. En quoi ont-elles modifié le métier de chercheur ?
Quand j’ai commencé, les publications permettaient d’être un peu connu et d’avancer un peu plus vite, mais ce n’était pas une condition pour faire carrière. Désormais, pour être embauché, il faut souvent avoir publié plus que ses professeurs et la valeur du chercheur est mesurée à travers ses publications et le coefficient des revues dans lesquelles il a publié. Ce système pousse à la fraude. Selon le rédacteur en chef de Lancet, une grande revue scientifique, la moitié des articles dans le domaine de la biologie et de la médecine sont plus ou moins falsifiés.
Le plus souvent, il ne s’agit pas de fraude massive, où le chercheur invente de toutes pièces des résultats, il s’agit plus de s’accommoder de la réalité, d’oublier de signaler ce qui ne fonctionne pas, de retirer un animal en disant qu’il n’est pas représentatif, etc. Cela peut aussi s’expliquer par le fait que, désormais, toute la recherche est financée par contrats. Or, répondre à des appels à projets prend énormément de temps et 90 % d’entre eux sont refusés, ce qui pousse à faire des promesses très audacieuses de résultats. Si les équipes n’y parviennent pas, elles sont tentées d’enjoliver la réalité de peur de ne plus avoir de contrats à l’avenir, ce qui est indispensable pour faire vivre une équipe. On raconte toujours les cas extrêmes de fraude, mais bien souvent, il s’agit de fraude tranquille, quotidienne. Et c’est très grave. La science est en train de mourir car c’est l’économie qui mène la barque. C’est dramatique pour les jeunes chercheurs, qui sont très doués, très sélectionnés, et qui peuvent quitter le bateau, dégoûtés de ces arrangements avec la réalité.
Pourquoi les citoyens restent-ils en dehors des orientations de la recherche ?
Toutes ces dérives viennent du manque de démocratie, du fait que la recherche est dirigée par le capitalisme, les lobbys industriels, l’armée. Il faut remettre les citoyens dans le jeu, mais pas de façon superficielle dans des organes où ils servent surtout de caution, et en saupoudrant les décisions de pseudo débats publics. Il faut un vrai rapport entre science et société, créer des dispositifs dans lesquels les citoyens peuvent questionner les chercheurs, donner leur avis éclairé sur les technologies et se prononcer en amont sur les priorités de recherche. On a besoin de sciences, et de certaines innovations, mais les grandes orientations doivent être données par les citoyens, pas par les scientifiques et surtout pas par les industriels.
Les réticences à prendre en compte la parole citoyenne émanent-elles plutôt des chercheurs ou des pouvoirs publics ?
De tous. Les chercheurs, surtout aujourd’hui, ont besoin de se valoriser, c’est un métier très dur, qui demande beaucoup et qui ne rend pas grand-chose. Les chercheurs veulent se faire croire que la science produit des « vérités » qui se situent au-dessus de l’opinion publique. Donner la parole au peuple, en amont des recherches, ce serait désacraliser la science, pensent-ils. Il y en a aussi qui estiment qu’ils produisent des résultats « scientifiques », et que c’est à la société de s’en emparer ou non pour en faire ce qu’elle souhaite. Ils ne veulent pas qu’on leur indique sur quoi travailler mais ils font semblant de ne pas voir que les résultats qui sont explorés le sont au bénéfice de l’économie.
Du côté des institutions, on entend les mêmes discours que ceux des lobbys industriels. Et ces derniers ne sont pas très chauds pour un regard critique en amont. Car si on laisse le choix entre augmenter les crédits de l’INRA pour la recherche sur les OGM ou augmenter les crédits de la recherche en agriculture bio, il est probable que les citoyens privilégient la dernière option. Les élus se contentent donc de développer quelques leurres démocratiques pour faire disparaître le mécontentement, en organisant des débats publics, des Grenelles, etc.
Les chercheurs sont pourtant aussi des citoyens. Pourquoi ne s’interrogent-ils pas sur les usages qui sont faits de leur travail ?
C’est comme les flics qui ne s’interrogent pas sur les coups de matraque qu’ils donnent. Avant, ceux qu’on appelait des savants touchaient à plusieurs disciplines, s’intéressaient aux sciences, à la philosophie, à la politique, ils s’interrogeaient sur plein de choses différentes. Maintenant, le chercheur est un technicien, c’est avant tout un employé et il n’a pas intérêt à ruer dans les brancards. S’il critique l’activité de ses recherches, il sera mis à l’écart, condamné par ses collèges. Il est difficile de se battre tout seul dans un milieu. Il y a toujours eu des lanceurs d’alerte mais ils ont toujours eu des difficultés. Il faut trouver des alliés à l’extérieur.
Et du côté des sciences sociales ?
Les sciences sociales sont en voie de récupération par le même système. On utilise la sociologie pour justifier de l’intérêt des technosciences. Par exemple sur les nanotechnologies ou le nucléaire, des sociologues sont financés par les entreprises et les pouvoirs publics pour travailler à rendre acceptables des technologies qui ne le sont pas d’emblée.
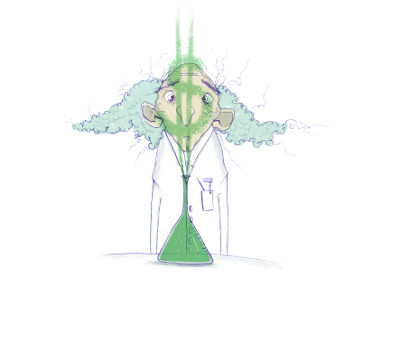 Que pensez-vous des sciences participatives ?
Que pensez-vous des sciences participatives ?
Quand les citoyens se prennent au jeu, ça montre leur intérêt à travailler pour le bien commun. Je ne suis pas contre le fait que les citoyens alimentent la machine de la recherche, mais à condition qu’on sache pourquoi l’on cherche. C’est bien de compter les papillons, mais c’est mieux de savoir pourquoi ils disparaissent : il faudrait plutôt faire un groupe de travail sur l’impact des produits phytosanitaires.
Et les sciences participatives ne doivent pas être confondues avec les sciences citoyennes, celles où les citoyens participent à répondre aux questions qu’ils se posent eux-mêmes. De plus, cela pose problème lorsque les sciences participatives ne visent qu’à diminuer le coût d’une recherche, voire à licencier, grâce à un service gratuit.
Pour sortir de cette impasse, vous évoquez le mot étrange d’humanitude et vous parlez des conventions de citoyens, pouvez-vous nous expliquer ça ?
J’ai créé le terme d’humanitude pour me moquer un peu de Ségolène Royal, mais surtout car il manquait un mot pour qualifier ce que j’ai vu dans les conférences et les conventions de citoyens. Ce sont des groupes de réflexion, où une quinzaine de personnes tirées au sort reçoivent une formation rigoureuse et contradictoire sur un sujet faisant controverse. Au bout du processus, qui dure plusieurs mois et qui implique des temps de débats avec différents intervenants, le groupe rend un avis public. L’humanitude, c’est une qualité double : cette intelligence collective, qui est infiniment plus grande que la somme des intelligences individuelles, et aussi cette forme d'empathie, d’altruisme, que les gens acquièrent lorsqu’ils sont en mesure de modifier le monde. Le citoyen possède l’intelligence de la vie en société, il dispose d’un panorama complet, ce qui le différencie de l’expert, qui a un point de vue froid sur un problème. L’humanitude, c’est le comble de l’humanisme et c’est ce qu’on ne voit presque jamais. Les gens sont la plupart du temps réduits à un état médiocre. Ils ne réagissent pas, ou pas selon l'intérêt collectif. Il y a un gâchis quotidien d’humanité dans tous les pays, car les humains ne sont pas mis dans la situation de donner le meilleur d’eux-mêmes.
J’ai pu observer d’après quelques expériences que souvent, ceux qui ont participé à ces procédures changent après car ils prennent conscience de leur propre valeur. Il y a une mine, là, dans ce processus, un truc extraordinaire qui produit des choses fabuleuses. Je n’ai pas une grande confiance dans l’humanité telle qu’elle se présente dans les sociétés de compétition mais il y a autre chose à en attendre.
Pourquoi l’idée n’est-elle pas plus reprise ?
En 2007, on a travaillé sur une proposition de loi pour définir et mettre en place les conventions de citoyen. On l’a fait connaître avec un article dans Libération, mais elle est restée dans les limbes. Yves Cochet s’y est intéressé en 2010 mais en voulant la simplifier et enlever ce qui faisait ses particularités. J’ai rencontré plein de députés qui ont tous dit que c’était génial. Mais il n’y a jamais eu de suite. Je crois que les puissants se méfient d’un citoyen tiré au sort et plus encore d'un citoyen éclairé.
Que peut-on faire ? On n’a pas de soutien, ni des médias, ni des politiques. Les innovations techniques seraient un bon exemple pour tester les conventions de citoyens mais les chercheurs y sont hostiles. Et les associations se sentent menacées car elles ne veulent pas perdre leur rôle d’interlocuteur de l’Etat. Elles sont d’accord pour que les citoyens s’expriment via un référendum, mais pas qu’ils préparent une décision. Pourtant, ça serait un bon outil pour les militants, bien mieux qu’un sondage d’opinion. Et les ONG auraient toujours un rôle à jouer car elles construisent l’expertise et pourraient intervenir comme formateurs. Mais il est important que le groupe soit constitué de citoyens profanes sur le sujet, qu’ils puissent entendre toutes les vérités avant de se prononcer, et que les politiques aient l’obligation de prendre en compte l’avis qui en résulte. Tout cela ne pourra arriver que si la procédure est d'abord légalisée.
Propos recueillis par Sonia
Dessin 1 : Stouff
Dessin 2 : Claire Cordel
Cet entretien est tiré du dossier "Sciences, un enjeu de société", paru dans le numéro 9. Vous pouvez commander votre numéro (4 €) ou vous abonner (15 €) sur cette page.
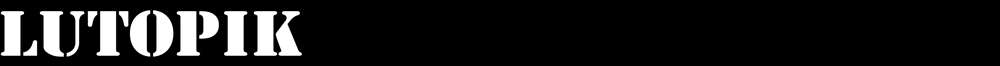





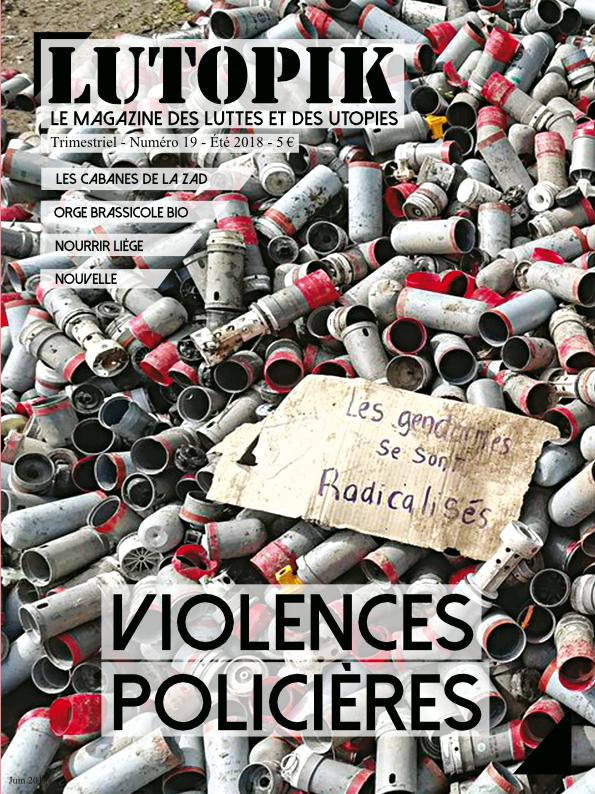
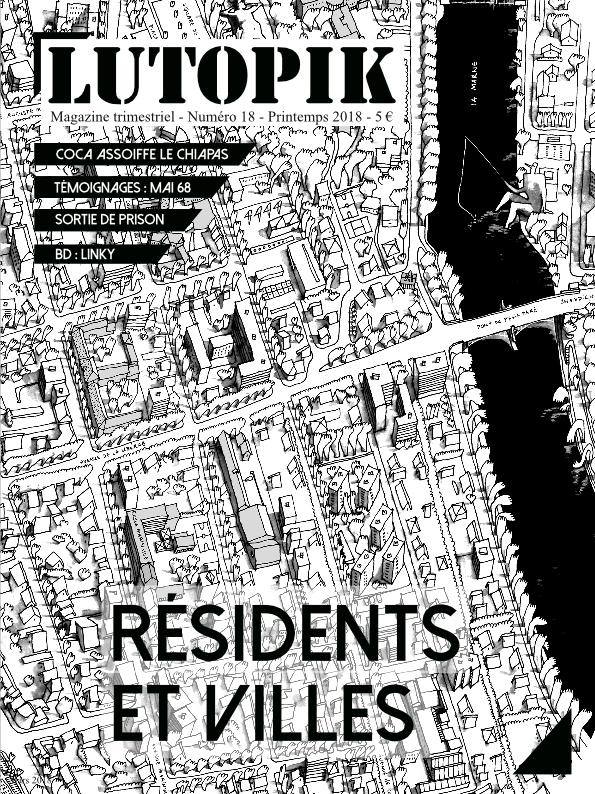
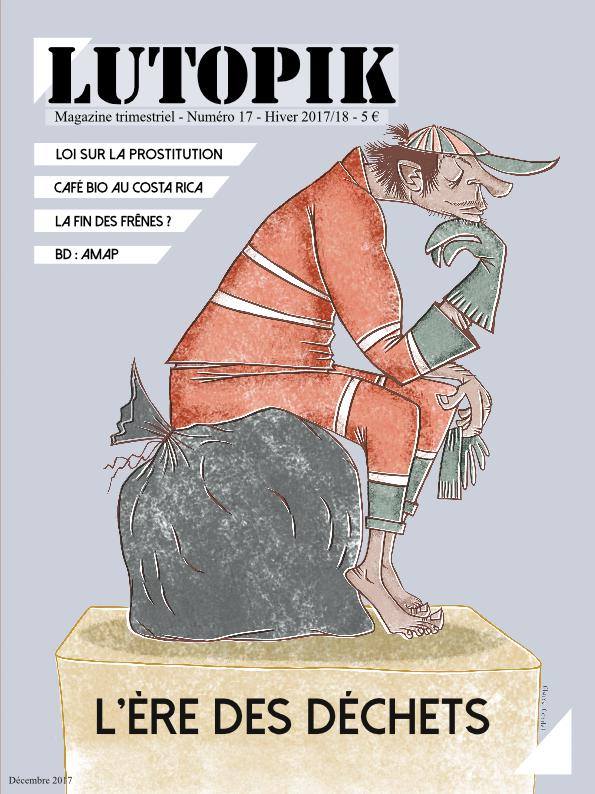

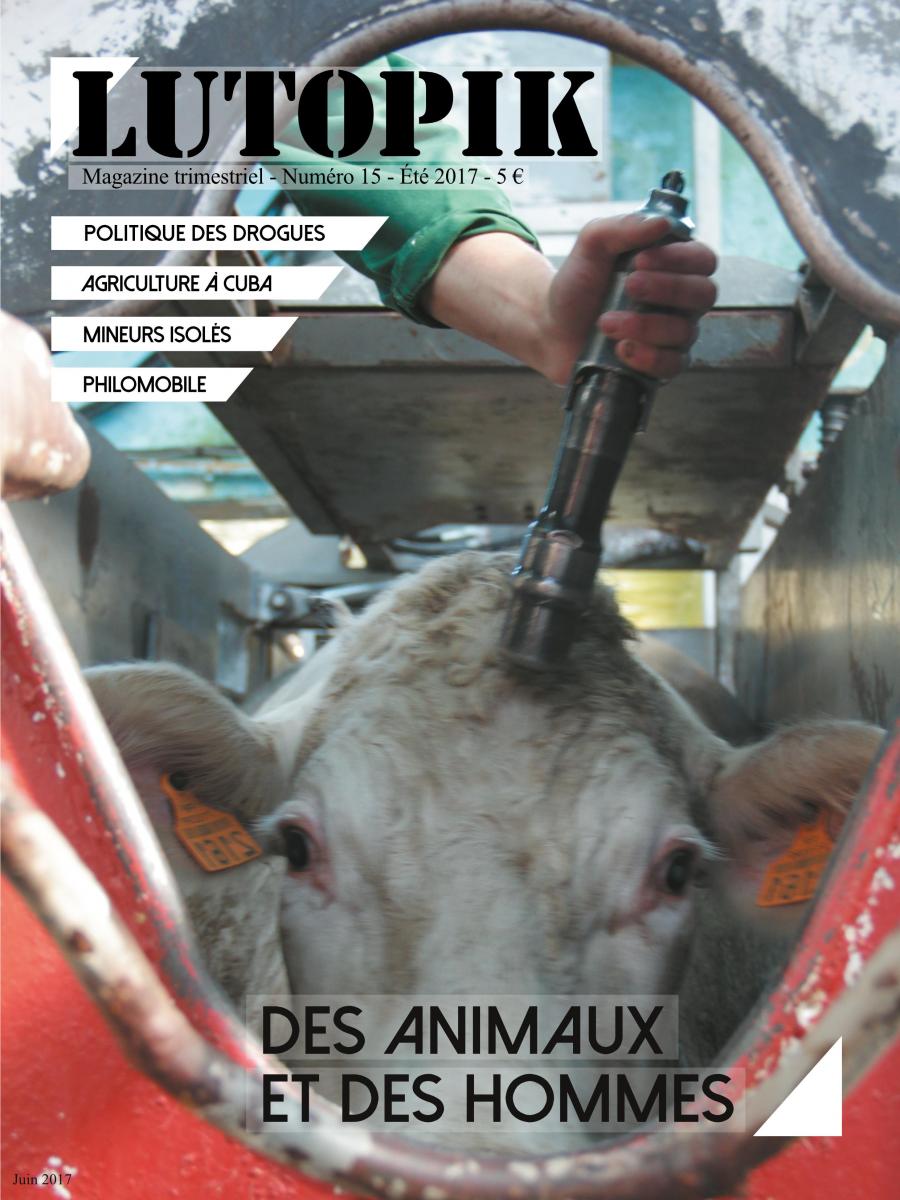




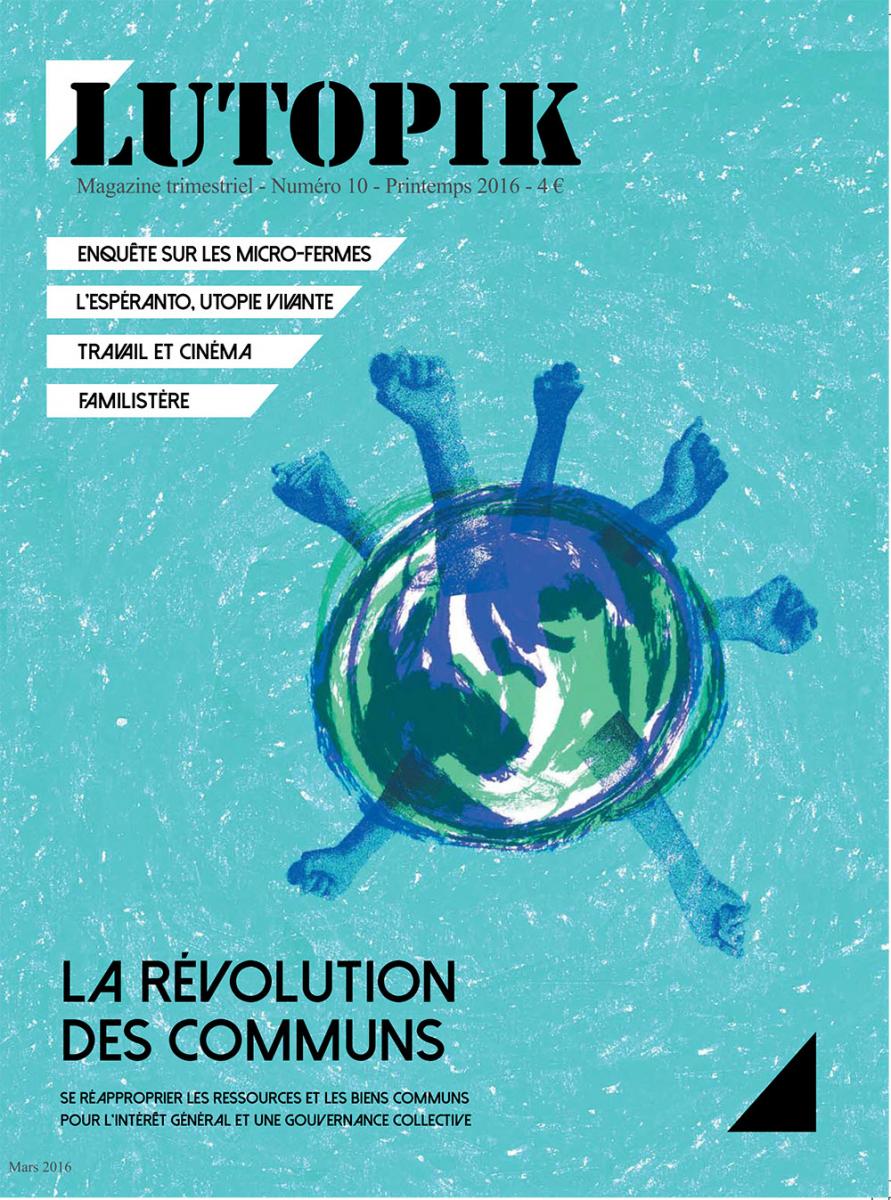









Commentaires
“Les sciences disparaissent