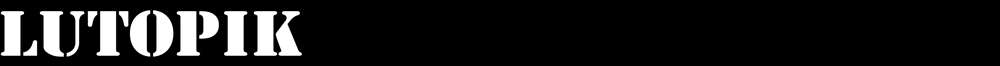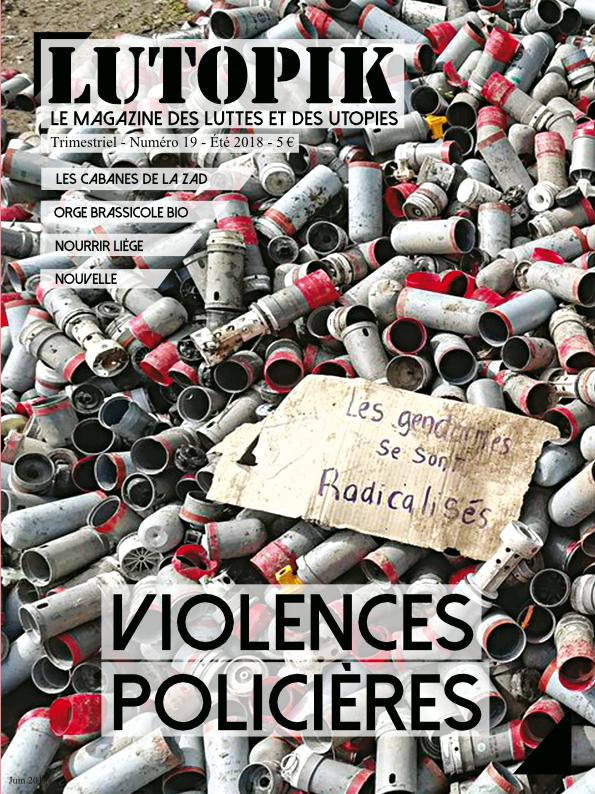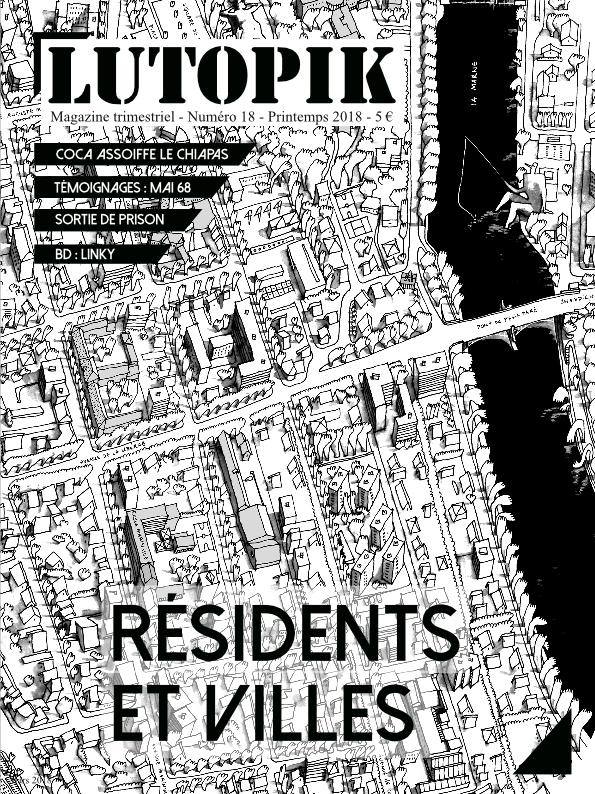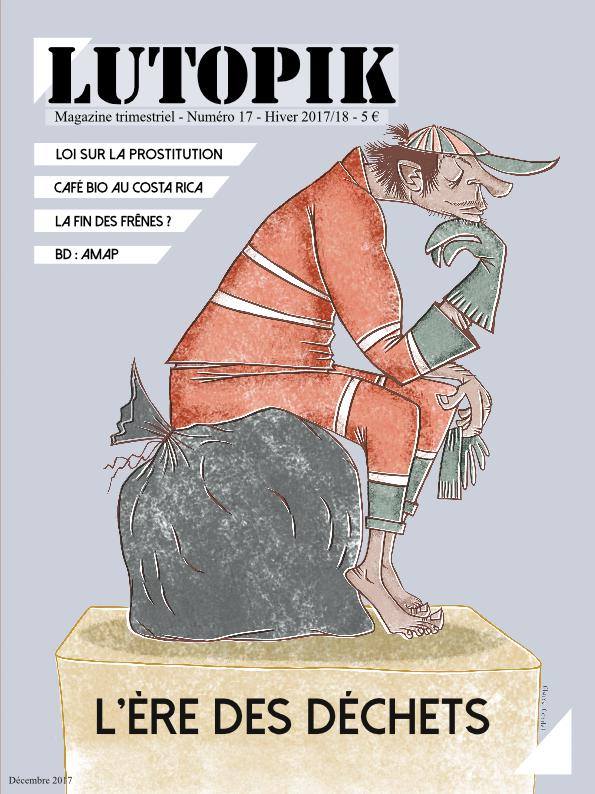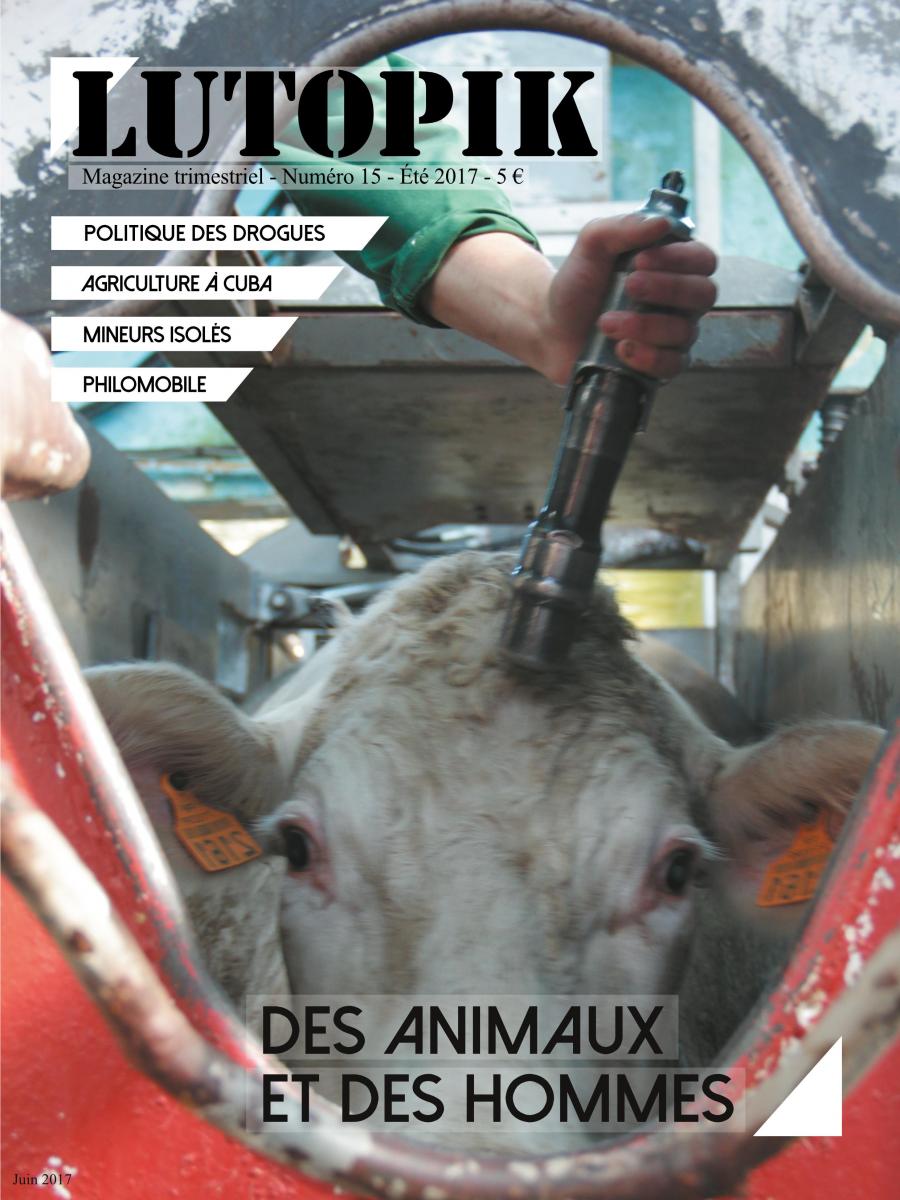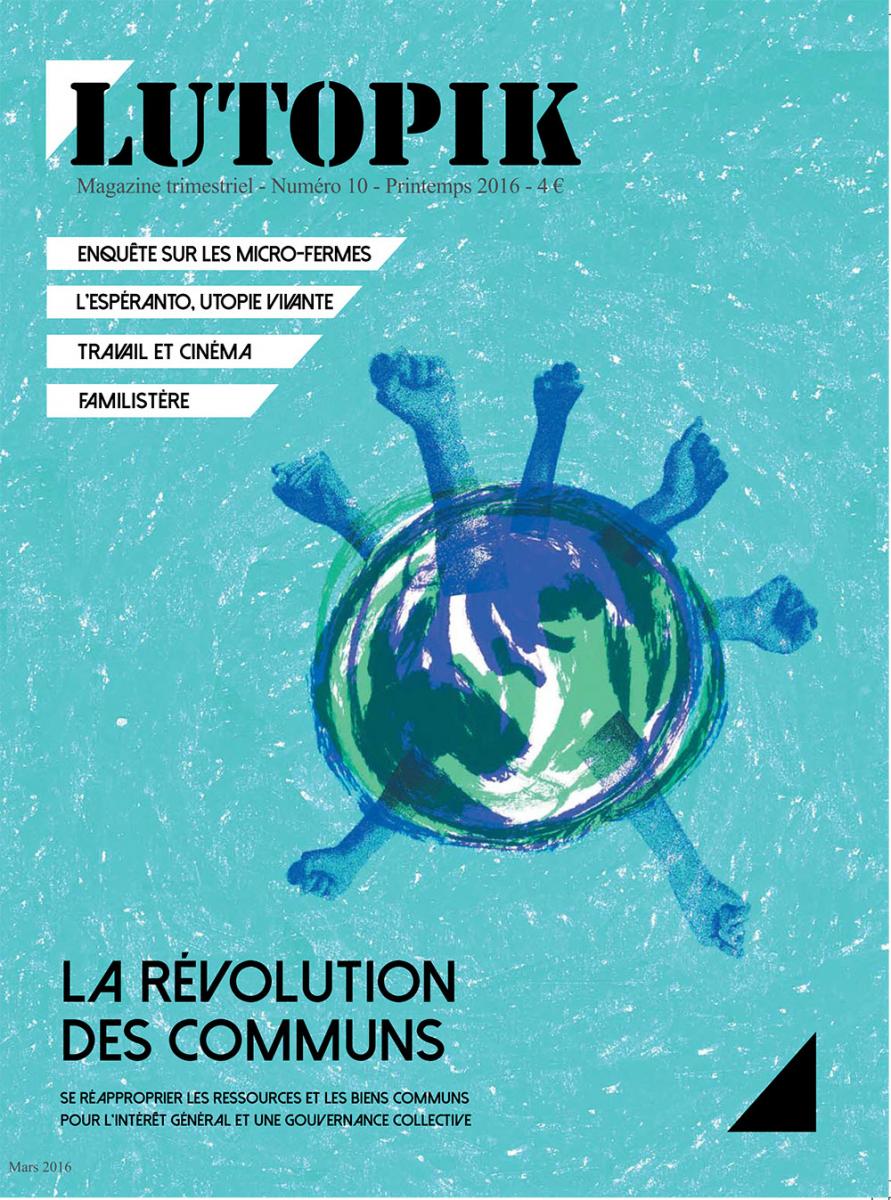« Les journalistes produisent une banlieue hors-sol »
 Interview - Jérôme Berthaut est sociologue des médias et auteur de La banlieue du « 20 heures » (éditions Agone, 2013). Ce livre est le résultat de plusieurs années passées en immersion au sein de la rédaction de France 2, afin de faire l’« ethnographie de la production d’un lieu commun journalistique » : le mauvais traitement de la banlieue dans les médias. Cet entretien a été réalisé en complément de l'article "La Révolte de la Villeneuve", tous deux parus dans notre dossier médias du numéro 7.
Interview - Jérôme Berthaut est sociologue des médias et auteur de La banlieue du « 20 heures » (éditions Agone, 2013). Ce livre est le résultat de plusieurs années passées en immersion au sein de la rédaction de France 2, afin de faire l’« ethnographie de la production d’un lieu commun journalistique » : le mauvais traitement de la banlieue dans les médias. Cet entretien a été réalisé en complément de l'article "La Révolte de la Villeneuve", tous deux parus dans notre dossier médias du numéro 7.
Pourquoi et comment vous êtes-vous intéressé au traitement médiatique des banlieues ?
Lorsque je commence mon travail de thèse en sociologie, nous sommes en 2003, une année après l’élection présidentielle qui a vu Jean-Marie Le Pen accéder au second tour. On disait beaucoup que c’était la faute des médias, qu’ils injectaient un point de vue idéologique, politique dans leurs reportages sur l’immigration et les quartiers populaires. Mon idée était de renouveler la façon d’étudier la production médiatique. D’habitude, les chercheurs partent d’un corpus de reportages et spéculent sur l’intention ou les conditions de travail des journalistes. Moi, j’ai suivi pas à pas les journalistes, depuis la proposition des sujets jusqu’à leur diffusion. Je me suis aperçu qu’en réalité, ils connaissent les effets réducteurs et stigmatisants de leurs reportages mais ils continuent de reproduire ces stéréotypes, ces raccourcis. Ce paradoxe est devenu le sujet de mon étude.
Comment expliquez-vous que les médias parlent de la banlieue quasi exclusivement sous des angles négatifs ?
Les sujets traités sont très liés au poids des sources. Les sources officielles, qui émanent des acteurs dominants capables de se faire entendre jusqu’à la salle de rédaction de France 2, sont beaucoup plus reprises que celles venant de petites structures comme les associations de quartier. Elles viennent des services de police ou encore du monde politique. Et comme depuis 1997, tous les grands partis ont fait de l’insécurité un thème majeur, c’est devenu un sujet récurrent dans les médias. De plus, on trouve très peu de reporters dans les conférences de rédaction des grands médias, les participants sont soit des chefs de service, soit les rédacteurs en chef. Ces derniers ne sont pas en contact avec le terrain et sont bien plus soumis aux propos des sources officielles. Et comme ce sont eux qui déterminent les commandes et décident de la diffusion ou non d’un reportage, tout cela contribue à produire une banlieue « hors-sol », c'est-à-dire une représentation faite en vase clos par ceux « d’en haut ».
A cela s’ajoute l’influence de ce que disent les concurrents. C’est la circulation circulaire de l’information, comme disait Bourdieu, où au final tous les médias tendent à faire la même chose. D’autant plus que les chefs de l’information de France 2 (David Pujadas, Laurent Delahousse, etc.) sont des anciens des chaînes commerciales. Ils ont donc intériorisé la façon de penser (fait divers égal sujet à part entière), et ont contribué à revaloriser ce type de reportages.
Pourquoi, alors qu’ils sont conscients du problème, les journalistes continuent-ils à produire ces reportages anxiogènes sur les quartiers populaires ?
Si les stéréotypes sont si prégnants, c’est pour leur fonction opératoire. Ils aident les journalistes à réaliser leur reportage, en balisant leur travail. Ils permettent aux journalistes de rationaliser le temps passé sur place qui est de toute façon trop court pour découvrir vraiment les lieux visités. En se focalisant sur les habitants et les scènes (tags, traces d’incendie…) conformes aux discours dominants sur « les banlieues », les reporters s’assurent aussi de satisfaire le point de vue et les commandes des chefs. Dans le cadre de mes travaux, ce raisonnement s’appliquait surtout aux JT, qui proposent des reportages assez courts. Mais on trouve la même chose dans des formats longs. Pour le reportage d’Envoyé Spécial (voir article suivant), la journaliste a passé trois semaines sur place. C’est énorme pour la télé. Et pourtant, son reportage reprend tous les clichés médiatiques de la banlieue. Pour rentabiliser les temps de tournages et respecter le contrat de production, on planifie et reconstitue pour la caméra les scènes que l’on veut.
Comment en est-on arrivé à faire appel à des fixeurs (ces intermédiaires que les journalistes utilisent d’habitude dans des pays en guerre) pour approcher de simples habitants en France ?
Les journalistes utilisent souvent des intermédiaires pour trouver leurs interlocuteurs : ce peut être des syndicats, des associations, etc. Ce qui est flagrant sur les banlieues, c’est que c’est systématique, en tout cas pour la télé. Ce sont souvent des bénévoles (élus, associatifs, grands frères...) qui jouent ce rôle et les journalistes sont persuadés qu’ils ne peuvent pas travailler sans eux. Dans les années 90, il y avait déjà des fixeurs dans les banlieues, qui sont des intermédiaires rémunérés, même s’ils n’étaient alors pas forcément utilisés par les grands médias publics. Lorsque j’ai commencé mon travail d’observation en 2003, France 2 avait deux fixeurs attitrés. L’une d’elles au moins était salariée par la chaîne et possédait même une carte de presse. Ce fonctionnement induisait d’ailleurs une surreprésentation du quartier ou de la ville dont elle était originaire.
L’arrivée de jeunes journalistes, parfois issus de ces quartiers populaires, peut-il changer le regard des médias sur les banlieues ?
Les journalistes issus des quartiers populaires restent tout de même peu nombreux. Le tri scolaire et social pour devenir journaliste est très sélectif. Pour ces jeunes qui travaillent à France 2, il est difficile de proposer d’autres angles sur les banlieues car le traitement des quartiers populaires est codifié. Ce sont soit des sujets qualifiés de « réalistes », soit des sujets dits « positifs ». Les premiers, les plus nombreux, abordent les difficultés de vie là-bas en mettant l’accent sur les déviances comme la délinquance, l’extrémisme religieux, etc. Les seconds, quant à eux, existent pour corriger la représentation dépréciative du plus gros volume des sujets diffusés. Ils sont tout aussi caricaturaux, comme par exemple le portrait d’un jeune qui a réussi. En plus, ces reportages sont peu valorisés au sein de la rédaction. Il est donc plus rentable pour la construction professionnelle de faire des sujets sur la déviance. Tout sujet proposé par un reporter doit, pour être accepté par les chefs de service, s’inscrire dans l’un des deux standards… ou alors être remanié pour y correspondre.
Propos recueillis par Sonia
Cet article a initialement été publié dans le dossier "Médias: ceux qui résistent, ceux à qui l'on résiste" du magazine numéro 7 paru en juin 2015. Pour le commander, ou vous abonner, rendez-vous ICI.