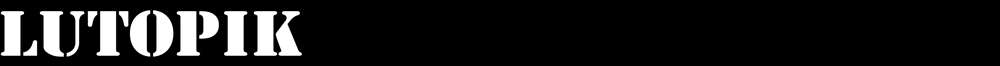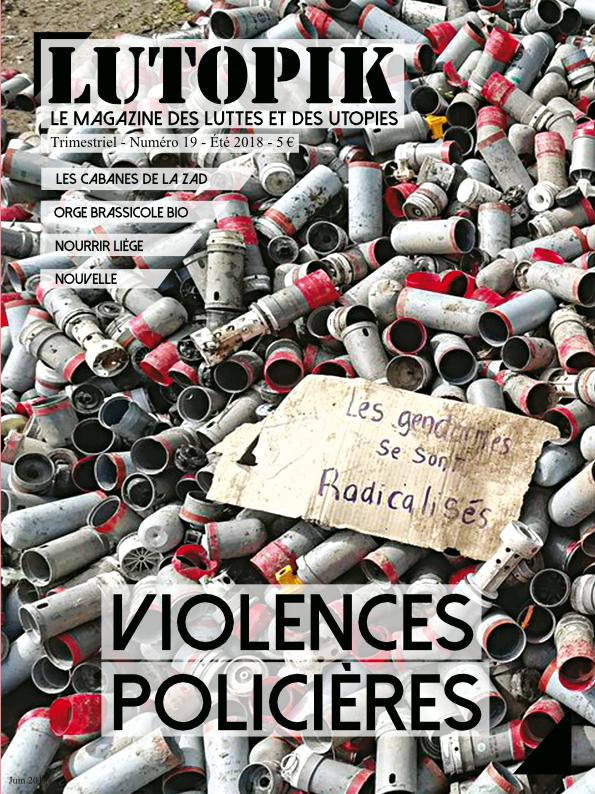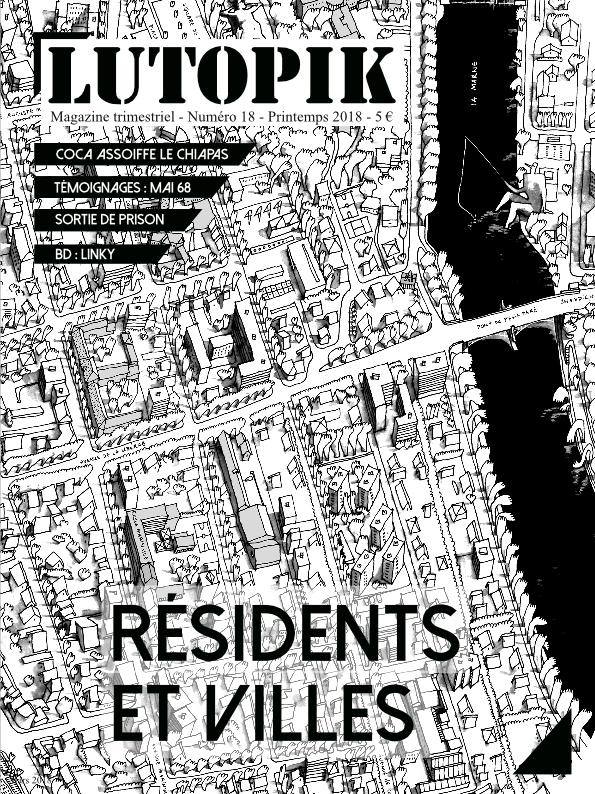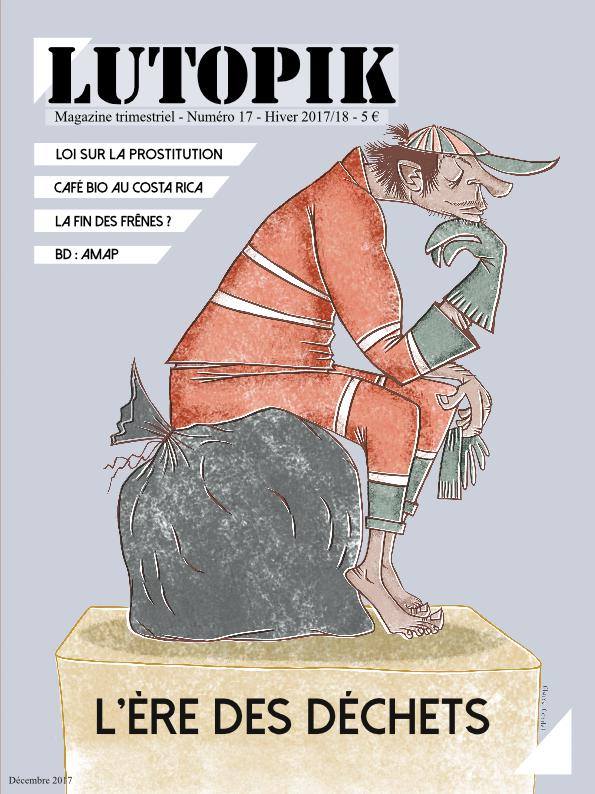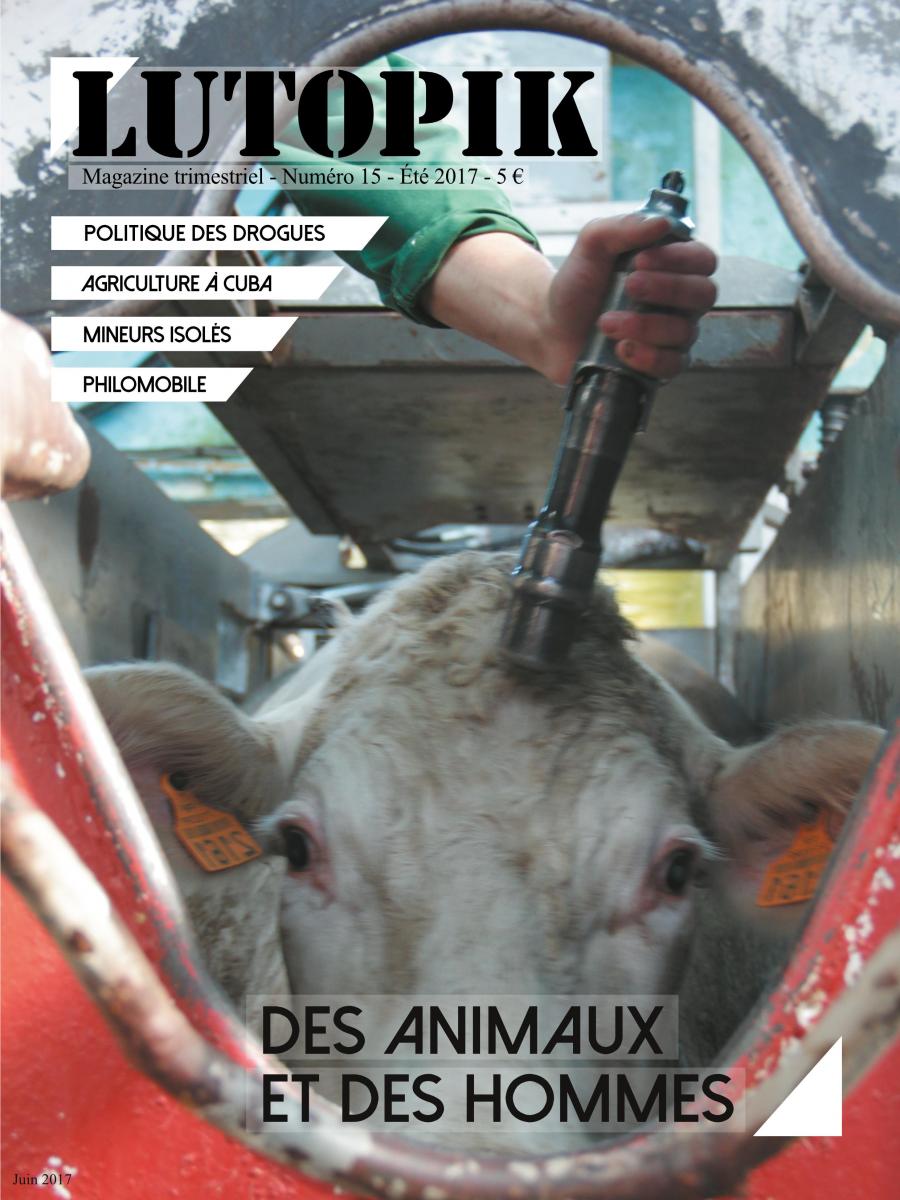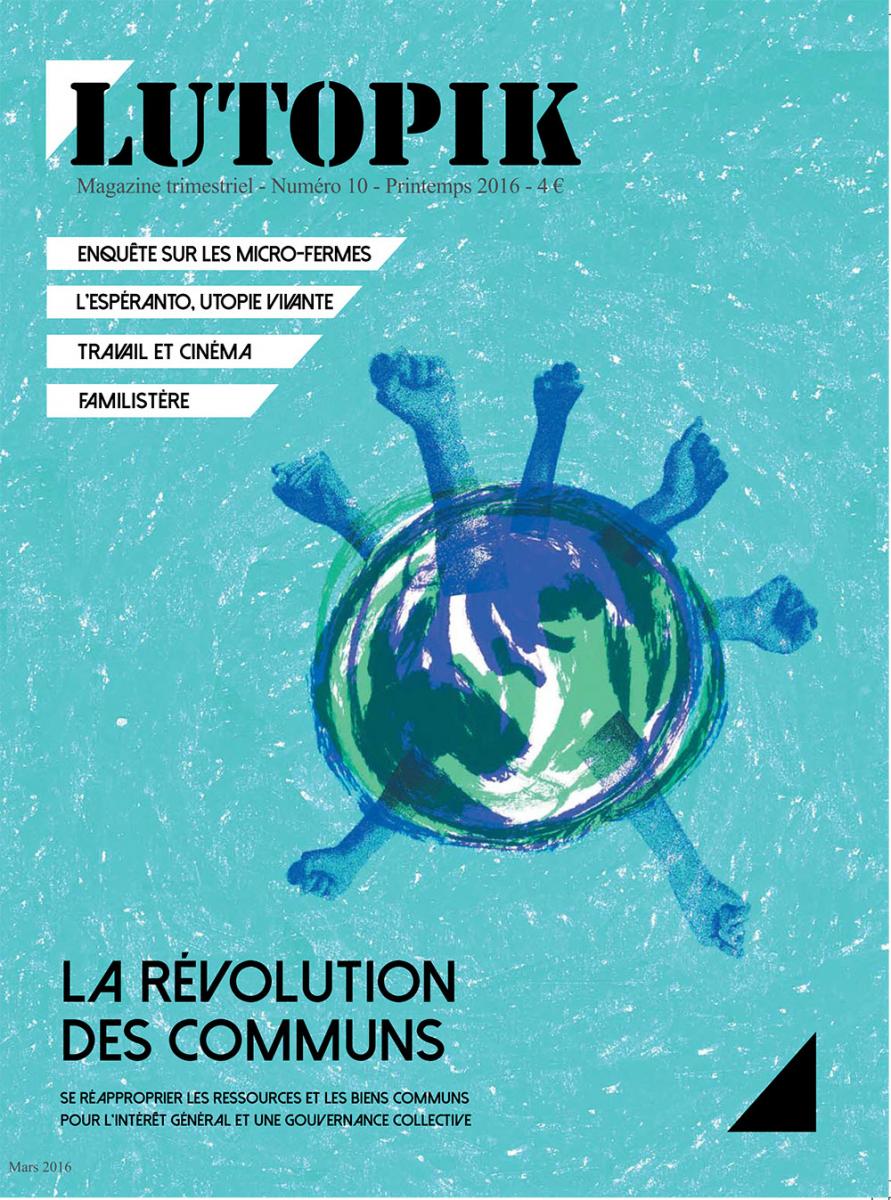Visite en neuroleptie / « L’injection est prête »
Pour finir avec le petit dossier sur la psychiatrie paru dans Lutopik #2, voici deux témoignages publiés initialement dans la revue Sans Remède n°4.
Visite en neuroleptie
« Allez, j’y vais, comme ça c’est fait ». J’ai honte d’avoir cette pensée, qui pourtant s’incruste avant chaque visite. Plus j’avance dans ce sens, plus je creuse un fossé entre lui et moi.
« Allez, j’y vais, comme ça c’est fait. » Est-ce par obligation ? Par culpabilité ? Avant tout je veux lui montrer par ma présence qu’il n’est pas seul. Pourtant j’ai du mal à y trouver un brin de plaisir. C’est la fin des vacances scolaires. Je ramène A. au train avant d’aller à l’HP de St Avé. Parfois nous y allons ensemble. C’est dur et grisant d’emmener un enfant dans cet endroit, surtout pour y voir son père. Horreurs des visites : 14h30. J’ai une demi-heure d’avance. La réponse, je la connais, mais je demande quand même à la blouse blanche si je peux voir E.. Elle me rembarre avec un sourire qui serait censé me faire patienter calmement. Un sourire qui m’énerve. Un sourire qui mériterait qu’elle le ravale et avec en prime son trousseau de clés, ses cachetons et sa bonne conscience. On ne déconne pas avec les horaires ici, bien que le temps semble ne pas exister.
Pour couronner le tout, il fait un temps dégueulasse. Un ton sur ton avec l’ambiance du lieu. Je me dirige vers la centrale de divertissement : la cafétéria. C’est une vraie micro-cité ici. Des panneaux de signalisation comme à l’extérieur, des noms de rue, des trottoirs... On se croirait presque dans un lotissement où l’illusion du paisible durcirait la croûte sur l’abcès. Je vais vite me poser à l’intérieur afin de noircir du papier, sinon je vais mal vivre ces secondes qui fabriquent des minutes. Un sablier au ralenti, les grains de sable à l’unité. Par la fenêtre, un coup d’œil sur le triste spectacle d’une architecture austère, bien pensée, tartinée d’une couche de blanc, véhicules de fonction assortis. Et le teint gris de toutes ces personnes qui errent sur le goudron. Un type, habillé simili-militaire entre, tout sourire aux lèvres et Rangers aux pieds, insigne de sécurité plaqué sur le torse. Il claque la bise à une blouse blanche travestie en serveuse de café dégueulasse. J’ouvre mon champ de vision. Assis autour des tables, des gens dont les expressions sont diverses, visiteurs, visités. Est-ce malsain de se demander dans quelles veines coule la chimie distribuée de force ? Sur certains visages, c’est une évidence. La bave blanche séchée aux commissures des lèvres, la salive coulant sur les vêtements, les muscles tellement relâchés qu’ils transforment les âmes en zombies. Et moi qui suis là, avec ma sale gueule en désolation.
Putain de parade des pieds qui traînent, des yeux dans le vide, des corps impatients, ça tourne en rond à en creuser des tranchées, des clopes sur clopes pour faire passer la pilule. Sur le mur sont projetés les jeux olympiques avec leurs athlètes forts et énergiques. La drogue semble être un point commun. Mais je doute que ces stars aux maillots publicitaires envient le terrain de jeu imposé ici. À travers la vitre je vois E. arriver, il a excessivement grossi depuis ma dernière visite. Sa démarche est fatiguée, son regard est vif et scotché à la fois. C’est à ses yeux que je peux savoir, sans qu’il ne me parle, qu’il est avec elle.
Nous nous saluons, et décidons d’aller dans la cour pour fumer. Quatre murs dont un, salement amoché d’une peinture représentant une plage. Comme si ça pouvait nous faire rêver. Des tables en plastique sponsorisées par Miko installées en rang et la pluie qui nous tombe sur le coin de la gueule. Pour couronner cette ambiance de rêve, deux caméras observent nos faits et gestes... au cas où... Je roule sa clope car les médocs lui ont fait perdre toute dextérité. On échange des banalités, comme souvent. Au bout d’un temps, elles s’épuisent et je ne sais plus où mener la discussion. J’ai du mal à jouer franc jeu car j’ai peur, je filtre mes paroles, je censure mes joies, je m’abstiens de te faire le récit de mes dernières histoires trépidantes, de mes envies, mes projets... Tout ça par peur que mes paroles ne te rabaissent, car j’ai une vie et que je ne peux considérer qu’ici on en ait une. Je censure mes doutes, mes flippes, mes angoisses, mes tristesses car je me dis que ce ne serait pas légitime, qu’il faut faire preuve de bienveillance, que mes émotions ne valent pas les tiennes et qu’il n’y a pas de place pour mes failles. Le jeu est faux, ma culpabilité l’emporte. La situation met notre franchise au bas mot. Nos rapports sont construits sur ton histoire et il me faudrait certainement déjouer ce déséquilibre.
Nous rentrons boire un café dégueu, même topo pour la tasse que pour la clope. La dextérité ne suffisait pas, il fallait qu’on lui enlève aussi la force de tenir un objet. Les médicaments l’ont complètement assommé. Tout mouvement lui est pénible, alors la pensée... Même avec des doses excessives de "neutralisants", ils ne l’auront pas eu, ils ne lui auront pas non plus retiré sa moitié, celle qui occupe son esprit et avec qui il partage sa tête. Celle que je connais si peu tellement elle est loin de ma réalité.
Il regarde dans le vide, le rictus au coin des lèvres. Je sens le moment arriver où il va me parler d’elle. J’ai peur, je ne sais pas comment réagir, je pars avec lui ou je fais bloc ?
Ici, c’est la merde, et j’ai hâte de partir. Ça me tord l’œsophage de penser qu’il va y rester. Que s’il ne l’ouvre pas trop, il aura le droit de rentrer chez lui, à condition de venir se faire piquer tous les quinze jours, et que s’il fait un pas de travers, l’UMD (Unité pour malades difficiles) lui est voué, et que s’il y va, il peut dire à son fils « on se retrouve pour tes 18 ans ». Ça me tord l’œsophage de constater qu’une fois encore, ils ont abusé de leur pouvoir, que ces neuf semaines consécutives d’isolement l’ont ravagé et qu’il a fallu remuer ciel et terre pour l’en sortir. Ça me tord le cœur de savoir qu’il y a quelques années, il fût martyrisé à coup de sangles et d’intubations. Ça me fait lever les poils de savoir qu’on nous a proposé de lui faire des électrochocs, histoire de le torturer encore plus... Et surtout ça me fout en l’air de constater que depuis plus de quinze ans la situation est la même et que je me sens plus qu’impuissante. C’est l’heure des séparations, tout le monde regagne son rang, tout est réglé comme du papier à musique.
La musique des pieds qui traînent, des voix sourdes et ralenties, de nos silences interminables. Des bémols accolés aux clés de sol précisant que les notes seront décalées à jamais. La fanfare du trousseau ouvrant la porte d’un enfer que lui seul connaît, le larsen des charnières rouillées fermant les issues. Je me retrouve nez à nez avec une vitre opaque et un tas de sales trucs en tête.
S.
« L’injection est prête »
G. nous raconte le tout premier rapport avec l’institution, le moment de la « prise en charge ».
Je monte de mon plein gré dans le véhicule de pompier qui vient me chercher. Les pompiers me posent sans cesse les mêmes questions quant à mon identité et à la raison qui m’a poussé à les appeler. L’un me déclare que je suis en pleine forme. Cela ne me rassure qu’un peu. À vrai dire, je me croyais dans un songe, où mon corps accidenté était allongé sans connaissance dans ce camion, et j’avais l’illusion de parler à ces hommes. Arrivé à destination. Où m’ont-ils amené ? Sans doute les urgences de cette ville qui ne m’est pas familière. Je leur dis que je ne souhaite voir personne, et désire dormir un peu. On m’installe dans un fauteuil dans l’entrée. Pas confortable de dormir assis ! Les idées défilent. Les gens aussi.
Le jour se lève, et on me propose de m’installer dans une salle cubique. Un psychiatre arrive, je discute avec lui. Il me fait penser à un comédien : il parle peu, reste statique pendant dix secondes, puis, change de position. Il quitte les lieux sans m’annoncer ce qui va se passer. Je dois uriner dans un flacon d’urine. Trop intimidé par ce lieu trop vaste, je n’y parviens pas.
Le temps passe, j’aimerais savoir ce qu’il va se passer. Je sors de ma cellule ouverte, pour interroger les infirmiers, mais n’obtiens pas de réponse. Je m’impatiente, et commence à être violent verbalement. Je pousse le vice à aller dans une autre cellule, où je déclare à un blessé léger que dans une autre vie il serait psychiatre.
Tout à coup on vient me chercher. Je les suis jusqu’à l’ambulance. Avant de monter, je demande où l’on m’emmène. Je n’obtiens pas de réponse. Là, je m’énerve et déclare : « c’est à la mort que l’on m’emmène ». Je vois au regard de l’ambulancière que je l’ai choquée. Mon seul refuge est de revenir dans ma cellule, ce que je fais violemment.
À peine installé, plusieurs infirmiers et les deux ambulanciers arrivent avec un brancard. De force, on m’allonge, on me baisse le pantalon. L’injection est prête. Je sens le produit dans mon fessier. Je suis maintenant attaché, seul dans ma cellule. Je me débats en hurlant. J’en arrive même à me faire tomber avec le brancard. La position est très inconfortable, je sens l’endormissement dû au produit. Les infirmiers reviennent pour relever le brancard, et je m’endors.
G.
Tous les numéros de Sans Remède sont consultables sur leur site Internet : sansremede.fr
Cette tribune fait partie d'une série de témoignages autour de la psychiatrie publiée dans le deuxième numéro de Lutopik, sorti en décembre 2013. Vous pouvez le commander ICI, ou le consulter en ligne ICI.