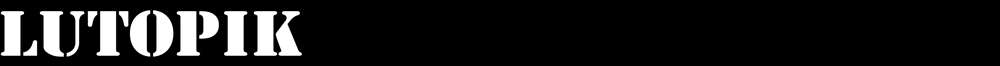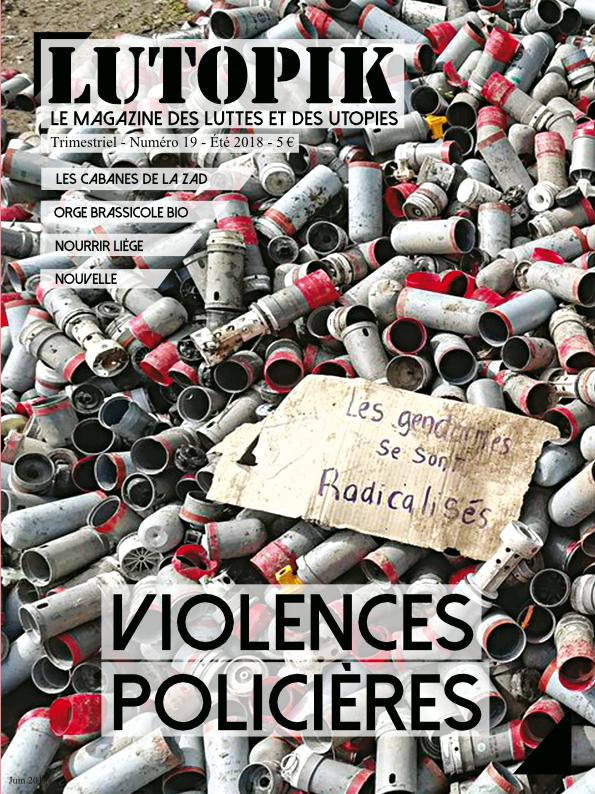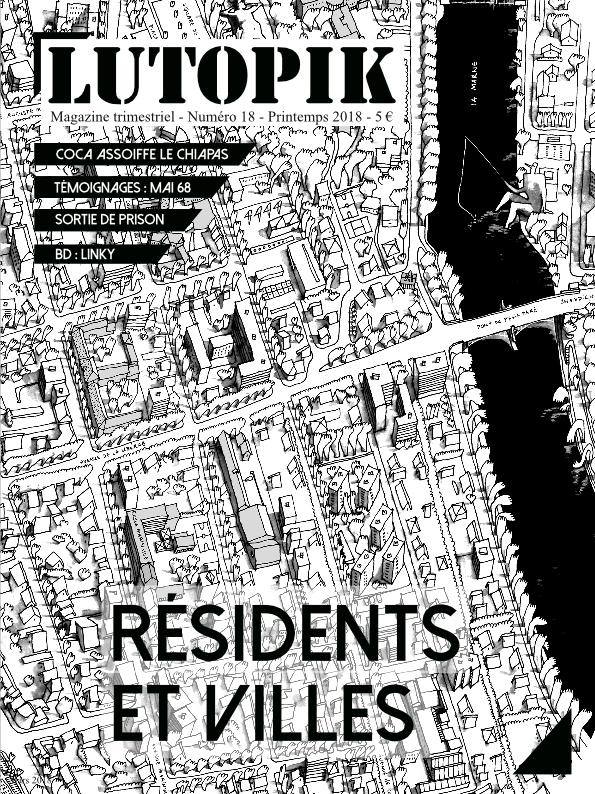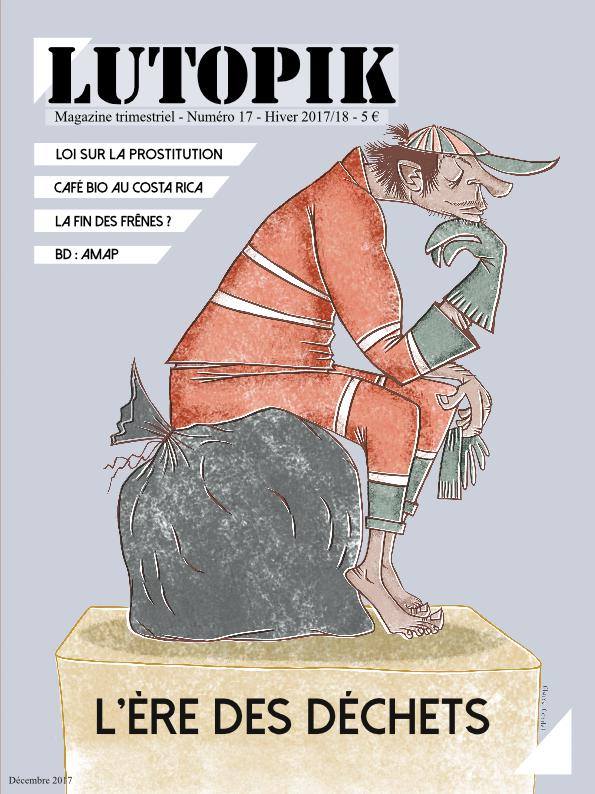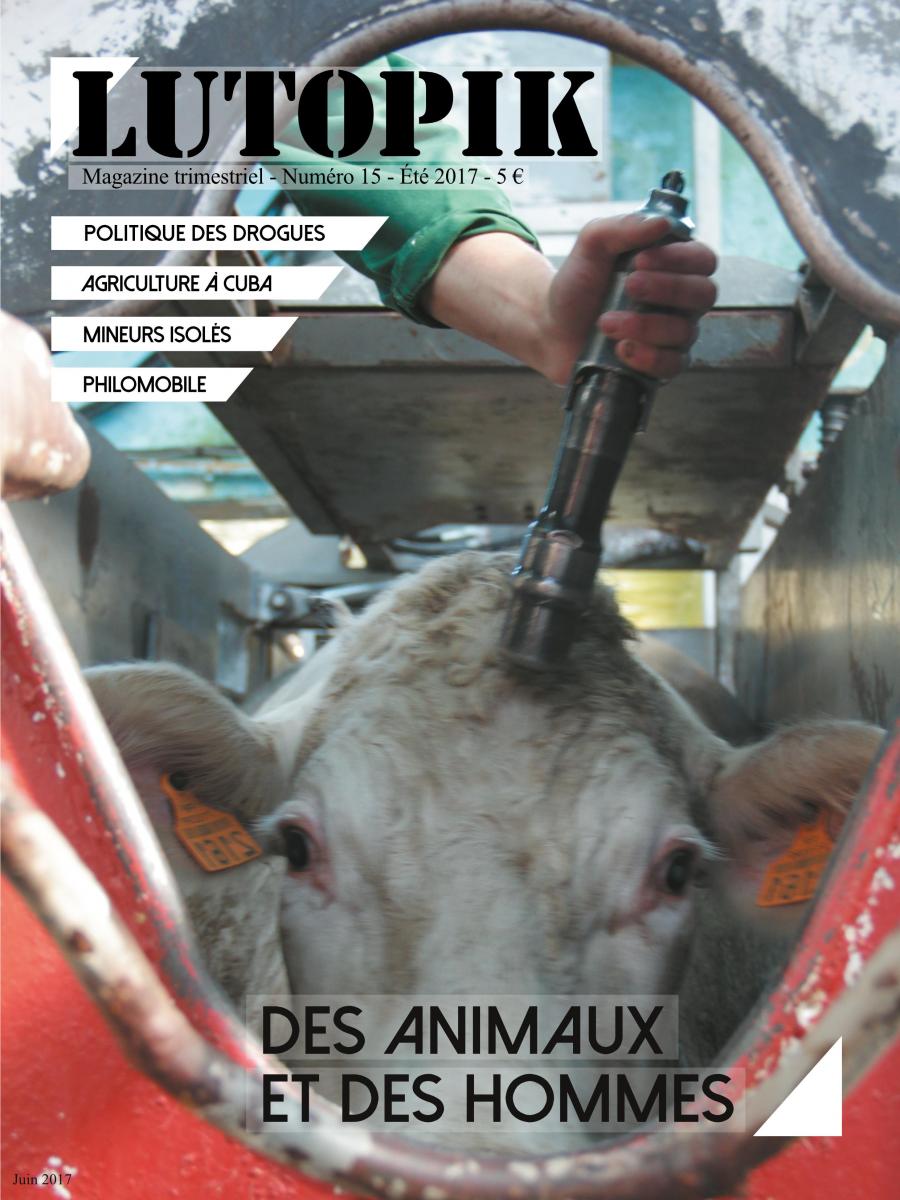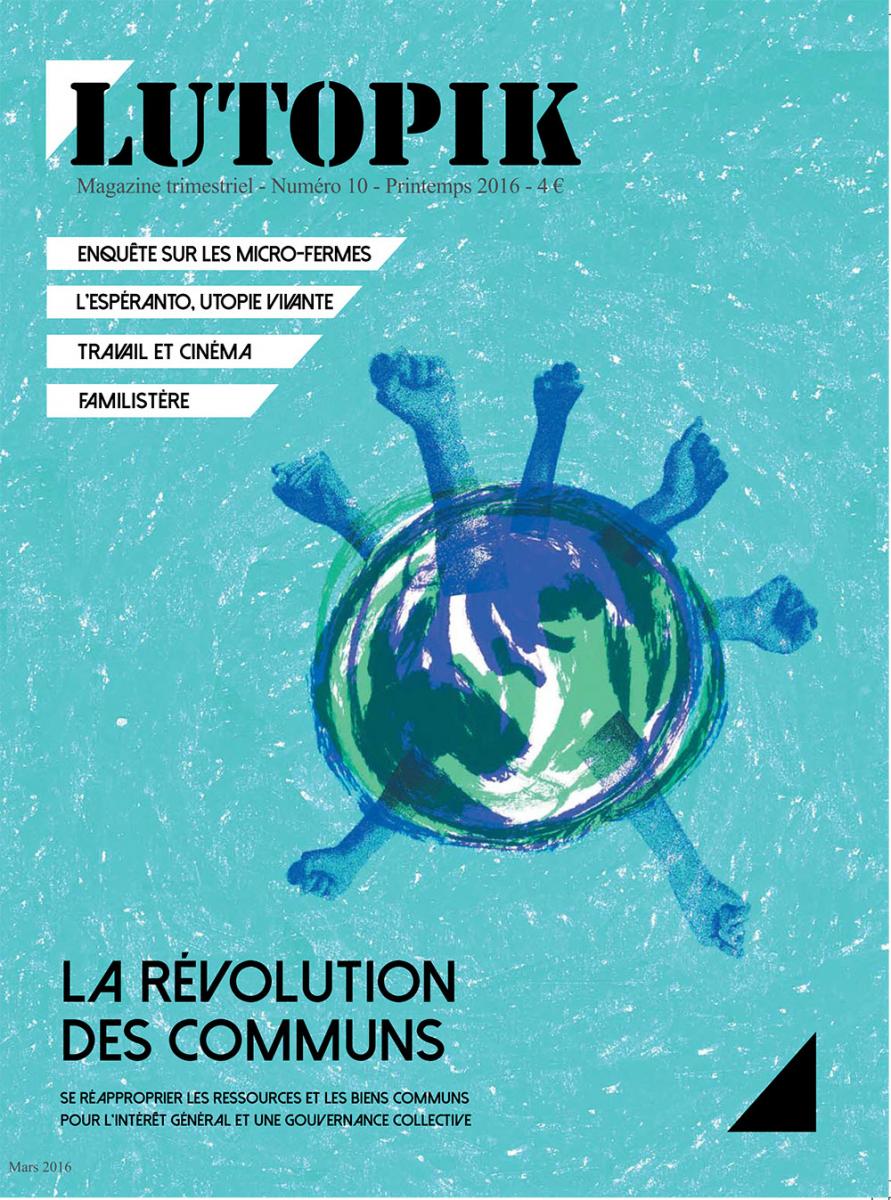Premières heures à Kasserine
Sur le bord de la route, plusieurs personnes impatientes de rentrer tentent d'arrêter des voitures. Certains parviennent à leurs fins en montant à bord de l'un des deux taxis qui passaient par là. Je décide de rester. J'attends. J'espère que la chance me sourira. On me demande une clope, je la donne. Le fumeur s'appelle Anouar et ne comprend vraiment pas ce que je viens faire ici. Il me répète lui aussi que c'est dangereux et qu'il n'y a rien à voir à Kasserine. Je lui explique que je voyage, que je veux découvrir comment les choses se passent ici. Je suis venu pour voir une autre Tunisie. Celle des pauvres et des laissés pour compte. Celle qui a commencé la révolution. Anouar est Kasserinois. Une fois le soleil couché, lui-même ne se sent pas en sécurité dans sa ville. Quand il me glisse qu'il peut éventuellement m’héberger, je n'hésite pas une seconde et lui dit que ce serait vraiment très aimable de sa part.
Un bus de remplacement arrive. Peut-être trois quarts d'heure ou une heure après la panne du premier. C'est reparti. Nous bavardons difficilement avec Anouar. Je ne parle pas arabe, lui se débrouille en français. Il me raconte sa dangereuse traversée jusqu'à Lampeduza. Il a « vu la mort » dans ce bateau en bois qui prenait l'eau et qui tanguait dangereusement. Il est resté un mois en Italie, deux semaines en France. Son rêve. Un contrôle de billets dans un train, puis d'identité, et c'est le retour en Tunisie. Il retentera sûrement sa chance. Légalement s'il le peut. La révolution ne le remplit pas d'espoir. Quand elle a éclaté ici, il était dans la rue. Il me dit qu'il a reçu une balle dans le pied, qu'il a rampé pour se mettre à l'abri. Kasserine a été la ville la plus touchée par la répression. Elle compte des dizaines de martyrs. Anouar a perdu des amis ces jours-là. Si on a fait la révolution ici, c'est avant tout parce qu'il n'y a pas de travail.
Routes défoncées
Arrivé au terminus, il me confirme son invitation. Nous prenons un taxi pour rejoindre son quartier. Je ne suis pas encore très rassuré. Nous traversons une voie de chemin de fer, de grands terrains vagues, des maisons qui semblent ne pas être finies. Il n'y a absolument personne dehors. Seuls les phares, et quelquefois des lampadaires, éclairent la route complètement défoncée. Nous arrivons devant une vieille Mercedes. « Celle de mon père » dit-il fièrement. Toutes les autres voitures stationnées que j'avais aperçues depuis les vitres du taxi étaient complètement désossées. Seules des carcasses gisaient encore sur le trottoir. Personne ne semblait en vouloir. Tout avait été pris.

Région ravagée par le chômage
Au réveil, je pars avec Anouar. Cette fois c'est lui qui conduit tant bien que mal la Mercedes. De jour, Kasserine n'est guère plus joyeuse. Il y a quand même plus de voitures roulantes que d'épaves. Nous rendons visite à quelques membres de sa famille. On retourne en ville prendre un café. C'est ici que l'on retrouve son père, il reprend la voiture pour aller je ne sais trop où. Sûrement dans un autre café. Brûlé un peu l'essence de contrebande venue d'Algérie. Voir s'il rencontre des amis. Nous faisons le tour du souk, on prend un sandwich, puis un cocktail banane-orange. On passe au local de l'association des diplômés-chômeurs qui comptent plus d'un millier d'adhérents. Nous visionnons les vidéos sanglantes des victimes de la révolution. Le seul pouvoir de l'organisme consiste à enregistrer les besoins de personnels de l'usine de cellulose, le plus grand employeur de la ville. Elle informe ensuite les jeunes sur les modalités du concours. Anouar ne travaille pas aujourd'hui. D'habitude, il est intérimaire à mi-temps à l'hôpital. Il s’occupe de la maintenance. Je crois que son emploi n'est pas déclaré et qu'il est payé par le gouvernorat. Sa femme est magasinière à l'école des arts et métiers. C'est une chance dans cette région ravagée par le chômage.